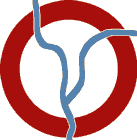Bientôt de nouvelles rames de métro
Publié le 06-03-2013 à 12h03
Le SyTRAL vient de lancer un marché de maîtrise d’œuvre en vue de l’achat de rames de métro supplémentaires. La description des prestations prévues dans ce marché éclaire en partie les évolutions envisagées sur le réseau dans la décennie à venir. En effet, la commande ferme des rames en question ne devrait pas intervenir avant 2016, d’où le nom MPL16 prévu pour la série, avec une livraison probable à partir de 2019 ou 2020.
À ce jour, le SyTRAL envisage d’acheter des rames à deux caisses et en nombre restreint, puisque au total se sont 48 rames (soit 96 caisses) au maximum qui seront commandées. La tranche ferme comprend 34 rames dont 22 destinées à l’automatisation intégrale de la ligne B (mesure indispensable en cette période de fort chômage : les emplois non délocalisables, autant les supprimer) et 12 pour le renforcement de capacité de la ligne D. La tranche conditionnelle de 14 rames serait à priori destinée à satisfaire un éventuel besoin né du prolongement de la ligne B aux hôpitaux sud, en même temps qu’un passage des trains de la ligne à quatre caisses.
Les rames qui seraient appelées à circuler sur la ligne D ne seraient en fait que des mulets (dit « Unités Trains Remorques » ou en abrégé UTR) accouplés en permanence à une rame de MPL85 qui leur transmettrait les informations du pilotage automatique. L’appel d’offre prévoit aussi que cette ligne sera potentiellement exploité e avec des rames aux compositions variables, c’est à dire de deux et quatre caisses. Gageons que l’exploitation à deux caisses sera réservée aux heures creuses ou au week-end. En effet, il est probable qu’en heure de pointe, les trains seront tous à quatre caisses. C’est-à-dire soit composés de deux MPL85 accouplés, soit d’un MPL85 et d’une UTR. Actuellement, en heure de pointe, il y a 30 MPL 85 en ligne, et le temps de rotation des rames est de 54 minutes. Chaque station de la ligne est donc desservie 33 fois par heure dans chacun des sens. Ce qui donne une capacité d’emport totale de 10 833 passagers par heure et par sens. Dans l’hypothèse où à l’avenir on aurait en ligne toujours 30 MPL85 et en plus 10 MPL16, cela permettrait de mettre en ligne de 20 trains à 4 caisses. (Ce qui laisse 6 MPL85 et 2 MPL16 en réserve ou en maintenance) Avec une vitesse des trains équivalente à l’actuelle, chaque station ne serait plus desservie que 22 fois par heure et par sens. Mais la capacité des trains étant doublée, l’emport total serait de 14 444 passagers par heure et par sens. Soit une augmentation de 33 % de capacité globale de la ligne.
Si l’arrivée des MPL16 sur la ligne D se traduirait par une diminution de fréquence, au contraire, sur la ligne B, il y aurait une hausse de celle-ci. Ceci pour la raison exactement inverse, puisqu’on y passerait des rames MPL75 à trois caisses à des rames MPL16 à deux caisses. Actuellement, il y a au mieux 11 rames à trois caisses en ligne ayant un temps de rotation de 34 minutes. Ce qui offre une capacité d’emport total de 8 560 passagers par heure et par sens. En posant les hypothèses qu’après l’introduction complète des MPL16, il y aurait entre 19 et 20 rames en ligne, et que le temps de rotation serait de 40 minutes entre Charpennes-Charles-Hernu et Oullins, cela permettrait d’assurer 28 à 30 passages par heure et par sens, et d’offrir une capacité d’emport théorique de 9 262 à 9 750 passagers par heure et par sens. Ce qui représente une augmentation de capacité globale de la ligne comprise entre 8 et 14 %.
Néanmoins pour l’instant, l’achat de ces nouvelles rames ne s’inscrit pas de manière claire dans un plan général de renouvellement du matériel roulant du métro et ce bien que les premières rames arrivées sur réseau, les MPL75 atteindront les quarante ans en 2015. Certes, ce matériel a été bien conçu et entretenu. Il n’est donc pas utopique d’espérer le maintenir en service jusqu’en 2025-2030. Ceci d’autant que l’ensemble de ce parc sera concentré sur la ligne A et donc de fait moins sollicité. Il est tout de même surprenant que le projet de commande ne porte que sur des rames à deux caisses qui de plus seront d’après l’appel d’offres « identiques (aux améliorations près liées principalement à la qualité de service et aux économies d’énergie) aux rames MPL85 circulant sur la ligne D. »
En effet, si le réseau manque actuellement de matériel roulant pour assurer le transport correct des passagers, il ne faut pas oublier qu’au moment du renouvellement général du parc, le MPL16 n’aura que 10 à 15 ans. À moins de lui faire subir le même sort que les MC 1 à 3 de la ligne C (mises au rebut après à peine 10 ans de service pour les plus anciennes), ce parc devra cohabiter pendant trente à quarante ans avec les successeurs des MPL75 et 85. Or si le MPL16 est un matériel quasi-identique au MPL85, il va comporter deux tares pénalisantes à long terme pour le réseau.
La première concerne la motorisation. En effet, un matériel calqué sur le MPL85 serait globalement sous-motorisé. Le tableau ci-dessous vaut mieux qu’un long discours :
| Matériel | Ville | Puissance massique (kW/tonne) |
|---|---|---|
| VAL206 (sur pneumatiques) |
Lille | 15,31 |
| MP89 CA (sur pneumatiques) |
Paris | 15,05 |
| MPM76 (sur pneumatiques) |
Marseille | 12,42 |
| MF01 (sur fer) |
Paris | 10,82 |
| MPL75 (sur pneumatiques) |
Lyon | 8,04 |
| MPL85 (sur pneumatiques) |
Lyon | 6,91 |
Tableau de comparaison des puissances massiques de différents matériels de métro. L’ensemble des calculs a été fait en considérant que les différents matériels sont à leur charge normale en nombre de passagers (4 par mètre-carré), et que chaque passager pèse 70kg (Un calcul à vide n’a aurait eu aucun sens). Le MF01 a été inclus, bien que sur roulement fer, car en dépit d’une résistance à l’avancement moindre liée à ce type de roulement on voit que ce matériel est nettement mieux motorisé que le matériel lyonnais.
La puissance massique du MPL85 représente nettement moins de la moitié de celle du MP89 parisien ou d’un VAL 206, vieux pourtant respectivement de plus de 20 et 30 ans. Elle est même inférieure à celle du MPL75 qui est loin d’être un foudre de guerre. Or une sous-motorisation implique que les rames ont des accélérations moins franches et quittent plus lentement les stations, ce qui réduit le débit global de la ligne. De plus, le matériel fonctionnant plus longtemps à ses limites pour atteindre sa vitesse de croisière, l’usure et en conséquence les risques de défaillance sont augmentés. Une puissance aussi faible exclu aussi l’ajout de remorque à ces rames.
Sur le long terme, il semble donc nettement pertinent d’acheter des rames nettement mieux motorisées. Idéalement, une multiplication par quatre ou cinq de la puissance installée par rapport aux MPL85 permettrait à la fois d’anticiper l’ajout de deux remorques mais aussi d’obtenir dans cette configuration des caractéristiques proches de celles du MP89. Naturellement pour la circulation en couplage avec le MPL85 pendant les 10 à 15 ans à venir, le logiciel de commande des moteurs des UTR devraient contenir un bridage correspondant aux courbes de traction des moteurs des MPL85.
La seconde est l’absence d’intercirculation intégrale sur la longueur de la rame. Or cette disposition accroît à la fois la sécurité et la capacité de transport. Sur ce dernier point, il convient de tirer les conclusions du passé. En effet, le matériel roulant a une durée de vie longue (au moins quarante ans, et au maximum 60 ans), sur laquelle les évolutions en termes de fréquentation peuvent être importantes et largement au-delà des prévisions. L’expérience de ces dernières années sur le métro lyonnais montre que toute réserve de capacité du matériel est bonne à prendre, car elle permet de différer les dépenses importantes d’augmentation du parc. De plus, la généralisation de par le monde du matériel roulant ayant une intercirculation dans les métros des villes du monde entier risque de donner d’ici quelques années une image particulièrement ringarde des réseaux où le matériel n’en dispose pas.
L’augmentation des fréquences sur la ligne B, liée à la capacité plus faible des rames risque au final générer des coûts de maintenance supérieurs du fait des parcours plus importants effectués. De même, il est à craindre que dans cette configuration le terminus à voie unique et le couloir de correspondance de Charpennes – Charles-Hernu ne sature encore plus, du fait d’un déversement continu de passagers en correspondance. Bref, ne vaudrait-il pas mieux acheter dès maintenant pour la ligne B 13 à 14 rames à 4 caisses, constituées par exemple deux motrices et deux remorques ?
L’ensemble de ces éléments devrait plutôt conduire au final à envisager l’achat de 12 rames UTR à deux caisses pour la ligne D, avec possibilité d’extension à quatre caisses au moment de la réforme des MPL85 (vers 2030 ou 2035), et 14 rames à quatre caisses pour la ligne B. Une telle option obligerait à l’achat en tranche ferme d’un total de 80 caisses (contre 68 actuellement prévues), mais resterait dans l’enveloppe du marché global envisagé entre les tranches fermes et conditionnelle. De plus, le coût global selon ce schéma pourrait être du même ordre que celui de l’option envisagée par le SyTRAL, car sur les 80 caisses 24 seraient des remorques, et seulement 56 des motrices…
Bref, à ce stade souhaitons que le SyTRAL se pose les bonnes question et évite de retomber dans les errements qui ont conduits à la construction puis à la mise au rebut des rames MC dans les années 1970, dont deux ont circulé une dizaine d’année, et la troisième à peine plus de six ans. Ceci par manque d’anticipation de l’évolution prévisible des besoins au moment de la commande des deux premières rames.